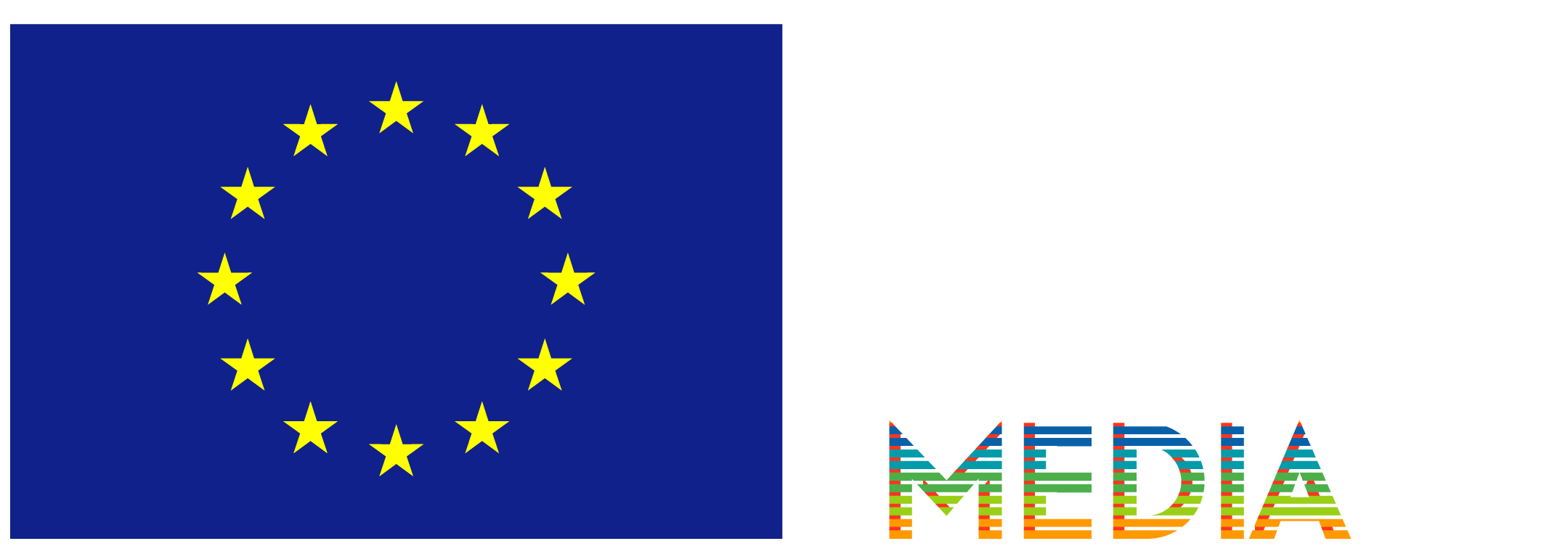3e partie du reportage consacré aux artistes d’Asie Riderz par Spraymium Magazine. Avec Priyesh Trivedi et Hideyuki Katsumata. Article complet à retrouver sur http://spraymiummagazine.com/asie-riderz-part-3/
—
Pour notre troisième volet sur Asie Riderz, nous allons nous attarder sur le travail de deux artistes : D’une part, de Priyesh Trivedi (Inde) et d’autre part, Hideyuki Katsumata (Japon).
PRIYESH TRIVEDI, créateur du personnage Adarsh Balak (आदर्श बालक)
Issu de l’industrie des films d’animation, Priyesh quitte à 23 ans ce milieu qui le frustre sur le plan artistique comme financier. Il créé alors le personnage nommé Adarsh Balak (qui signifie en hindi « garçon idéal ») sous forme de bandes dessinées. Un an plus tard, le voilà déjà bien connu en Inde et ailleurs grâce au buzz provoqué par ses dessins humoristiques teintés d’humour noir publiés sur Internet, à l’aune d’une contre-culture virulente. Dans le cadre d’Asie Riderz, l’artiste a choisi de mettre en scène son personnage fétiche au sein d’une peinture dont le visuel est reconnaissable dans le monde entier : véritable image d’Épinal, la fresque de l’évolution de l’homme est en effet reprise dans presque tous les manuels scolaires d’histoire. Champ de prédilection de Trivedi, les messages de propagande des livres d’école offrent matière à réflexion : tout en les tournant en dérision, il nous fait nous interroger sur la manipulation des masses et le conditionnement des plus jeunes à la bien-pensance.
Peux-tu nous expliquer qui est ce personnage appelé Adarsh Balak ?
Adarsh Balak s’inspire d’une série d’illustrations qui ressemble graphiquement à celles du « Garçon Idéal » (The Ideal Boy) paru dans les livres scolaires des années 80-90 édités par DEPOT. À travers ces images détournées du garçon « bien élevé », je fais allusion au lobbying développé par le NCC auprès de la jeunesse.
[NDLR : On voit ce sigle sur l’une des planches de l’Ideal Boy (joins the N.C.C.) données en contrepoint. Il signifie National Cadet Corps : corps militaire pour jeunes lycéens, collégiens et universitaires basé à New Delhi, ce dernier recrute semble-t-il sur la base du volontariat. Il forme les étudiants au patriotisme et à la discipline, et les entraîne aux parades et au maniement des armes. Dans leur forme, certaines illustrations de Priyesh reprennent les codes des affiches de propagande politique ou de publicité pour mieux en détourner le sens].
Comment est perçu ton personnage en Inde et ailleurs ?
Depuis mai 2014, ma page Facebook [NDLR : une page que Trivedi alimente régulièrement avec de nouveaux dessins, qui est suivie actuellement par 89 000 fans] est devenue culte : en détournant avec humour l’iconographie traditionnelle, je me suis attiré l’engouement d’un public jeune avide de subversion. Mais j’ai reçu aussi des menaces, évidemment. Les causes que je défends, comme l’émancipation des femmes ou le fait de fumer la marijuana, ne sont pas du goût de tout le monde. Il faut savoir que dans notre culture, le cannabis est une plante sacrée et utilisée depuis des milliers d’années. Je pense que la loi d’une nation ne devrait jamais prévaloir sur la loi de la nature. Le fait de vivre dans un pays qui déclare une plante illégale est l’un des signes que nous vivons dans une société aussi oppressée que n’importe quelle société passée [NDLR : de fait, de nombreuses planches sont consacrées à la thématique de la drogue].
Comment as-tu vécu cette popularité soudaine ?
Évidemment j’étais très content que mes dessins plaisent et surpris du phénomène viral, mais je sais aussi que tout est effet de mode. J’essaie donc de trouver de nouvelles idée pour ne pas que l’engouement ne s’essouffle. Mais je suis fataliste quant au succès possiblement éphémère de mon personnage et j’y suis préparé. De toute façon, je suis quelqu’un qui se lasse vite et me renouveler est pour moi une nécessité.
Et quid de la fresque réalisée dans la péniche ?
C’est mon interprétation de la fresque de l’évolution de l’homme où j’intègre Adarsh Balak. Elle reprend les différents outils qui nous ont fait « évoluer », comme la télévision, le Coca-Cola ou le Mac Book qui sont des objets de consommation de masse. La partie droite de la fresque montre que tout ceci détruit notre planète à petit feu. Je ne supporte pas non plus la publicité c’est pourquoi les affiches sont en flammes. En Inde, on ne voit que ça partout, il y a des affiches dans toutes les villes. L’unique préoccupation des premiers hommes sur terre était de trouver de la nourriture. Nos besoins depuis ont bien changé…
Le propos est de critiquer notre société consumériste qui nous fait croire que ces objets dont on voir les pubs partout font notre bonheur. On les retrouve désormais dans toutes les cultures, conséquence de la mondialisation. Pour autant, je vise aussi les paradoxes de ce système dans lequel même pour les populations les plus pauvres, avoir le dernier modèle de Nike est une priorité.
Usant du pinceau, l’artiste (qui ne porte pas de Nike et n’a pas d’iPhone !) est de nature solitaire et ne se sépare que rarement de ses écouteurs. En parodiant l’esthétique naïve et les couleurs pastel de ces planches qui font l’article du « garçon idéal », Priyesh Trivedi parle à toute une génération qui a grandi comme lui avec des images fausses. Aujourd’hui, ses dessins se vendent comme des petits pains sous forme de prints numérotés et signés via sa page Facebook. Facebook, par qui le buzz est né. Ce réseau social devenu un mal nécessaire serait pourtant bien l’une des cibles supposées de Priyesh Trivedi : comme outil de manipulation des masses et moteur de consommation, on ne fait pas mieux ! Les idées subversives et la critique positive auront-elles encore longtemps droit de cité sur la toile ? À méditer…
HIDEYUKI KATSUMATA : hanté par les Yōkai
Dans notre interview des jumelles Hamadaraka, nous avions évoqué les Yōkai. Il semble important de s’attarder sur ce concept typiquement nippon pour mieux comprendre l’univers de l’illustrateur Hideyuki Katsumata. Yōkai est un nom générique désignant de façon indistincte les monstres et créatures issus du folklore japonais traditionnel. Les deux kanjis composant l’expression se traduisent par « étrange » ou « paranormal ». Créatures possédant le don de métamorphose et des pouvoirs magiques, la plupart d’entre elles sont hostiles à l’égard des humains,. En rencontrer est donc a priori un mauvais signe. On les trouve partout, dans la nature ou les bâtiments abandonnés. En milieu habités, considérées comme domestiques, elles apportent au contraire paix et prospérité au foyer. Les peintres et artistes de l’ère Edo se sont abondamment inspirés des Yōkai. Puis, avec la modernisation du Japon, ces derniers sont tombés aux oubliettes, pour renaître dans les années 60 sous le crayon du mangaka Shigeru Mizuki.
Fort de cet héritage, Hideyuki Katsumata réinvente les Yōkai avec son esthétique propre, empreinte d’un psychédélisme aux couleurs acidulées qui a fait son succès depuis ses premières expositions en 2002. Ses monstres protéiformes prennent vie au travers d’illustrations pour des magazines, des pochettes d’albums ou des films d’animation. Une imagination foisonnante que l’on peut voir en mouvement sur sa page Youtube. A découvrir notamment, cette collaboration lyrique avec la chanteuse Simone White ayant pour titre « In the water where the city ends », réalisée un an après Fukushima :
L’artiste cite volontiers l’animisme pour parler de ses influences dans son art. En plus des Yōkai, il évoque Yao Yoruzu, ce dieu qui existait dans toute chose avant le christianisme, et qu’il s’est mis à peindre à l’acrylique sous toutes les coutures (c’est le cas de le dire puisqu’il a travaillé auparavant dans le textile) depuis l’âge de 25 ans. De cette croyance découle le profond respect que les Japonais ont pour la nature, car derrière chaque manifestation naturelle se cache un dieu.
Même si aujourd’hui le paranormal semble relégué au rayon pour illuminés en mal de sensationnel, on a pourtant le sentiment que Katsumata croit dur comme fer en l’existence des esprits qu’il invente. Ses démons semblent pris dans la tourmente d’un chaos de formes et symboles entremêlés, à mi-chemin entre les estampes érotiques (shungas) et les monstres de séries TV japonaises où il y a toujours un méchant monstre à combattre. La fresque réalisée pour Asie Riderz, un panneau de 4x2m, en est un bel exemple et qui plus est fusionnel, puisqu’il comporte des éléments dessinés par les jumelles Hamadaraka.
Ces compositions fourmillant de vie semblent rappeler l’homme moderne à ses racines, à la spiritualité, aux fondements de sa culture. Plus généralement, l’empreinte forte de l’occultisme dans les imageries respectives des artistes vus dans la péniche nantaise montre que l’art est une passerelle possible pour faire resurgir des valeurs traditionnelles perdues au détriment d’une libéralisation galopante dans laquelle l’homme se perd totalement. Au fond, que ce soit en Inde ou en Asie, les artistes semblent avoir des préoccupations similaires : car si Trivedi déplore le consumérisme à outrance et Katsumata réveille la tradition oubliée, c’est bien de l’âme humaine dont il est question au travers de ces travaux pourtant très différents.
Texte : Chrixcel
Photos : Chrixcel & David Gallard
—
Article complet à retrouver sur http://spraymiummagazine.com/asie-riderz-part-3/